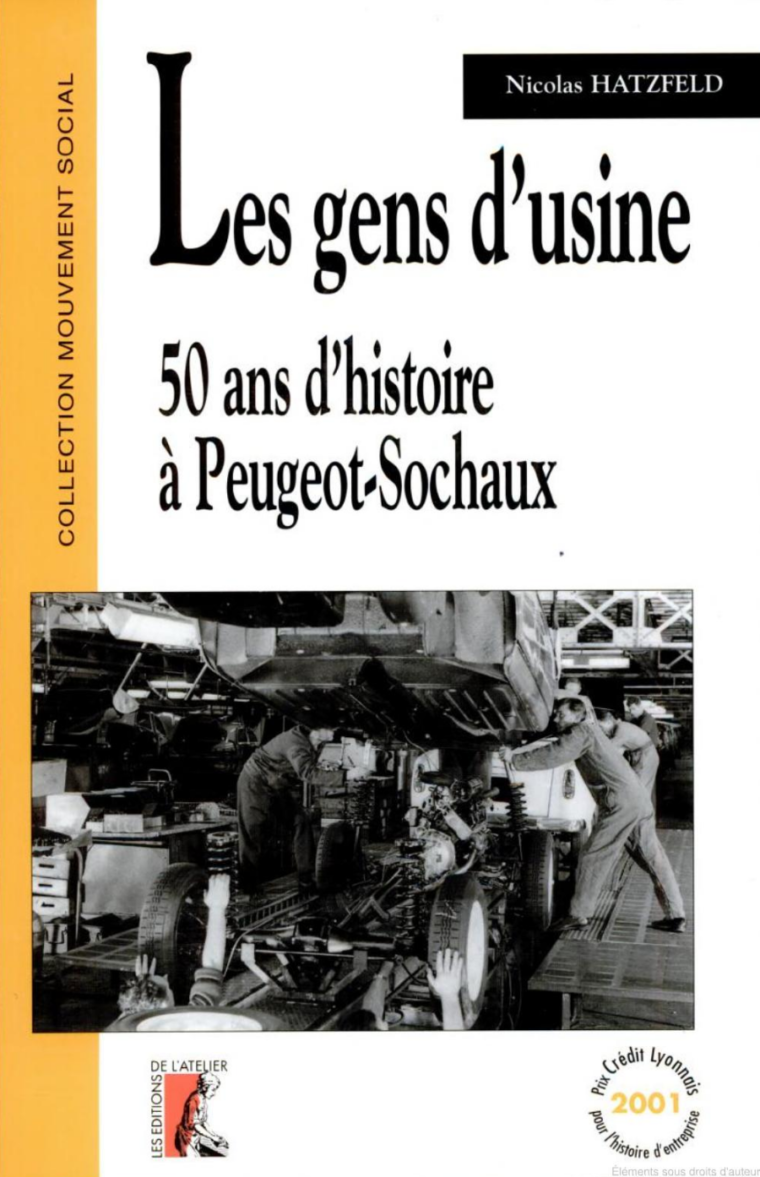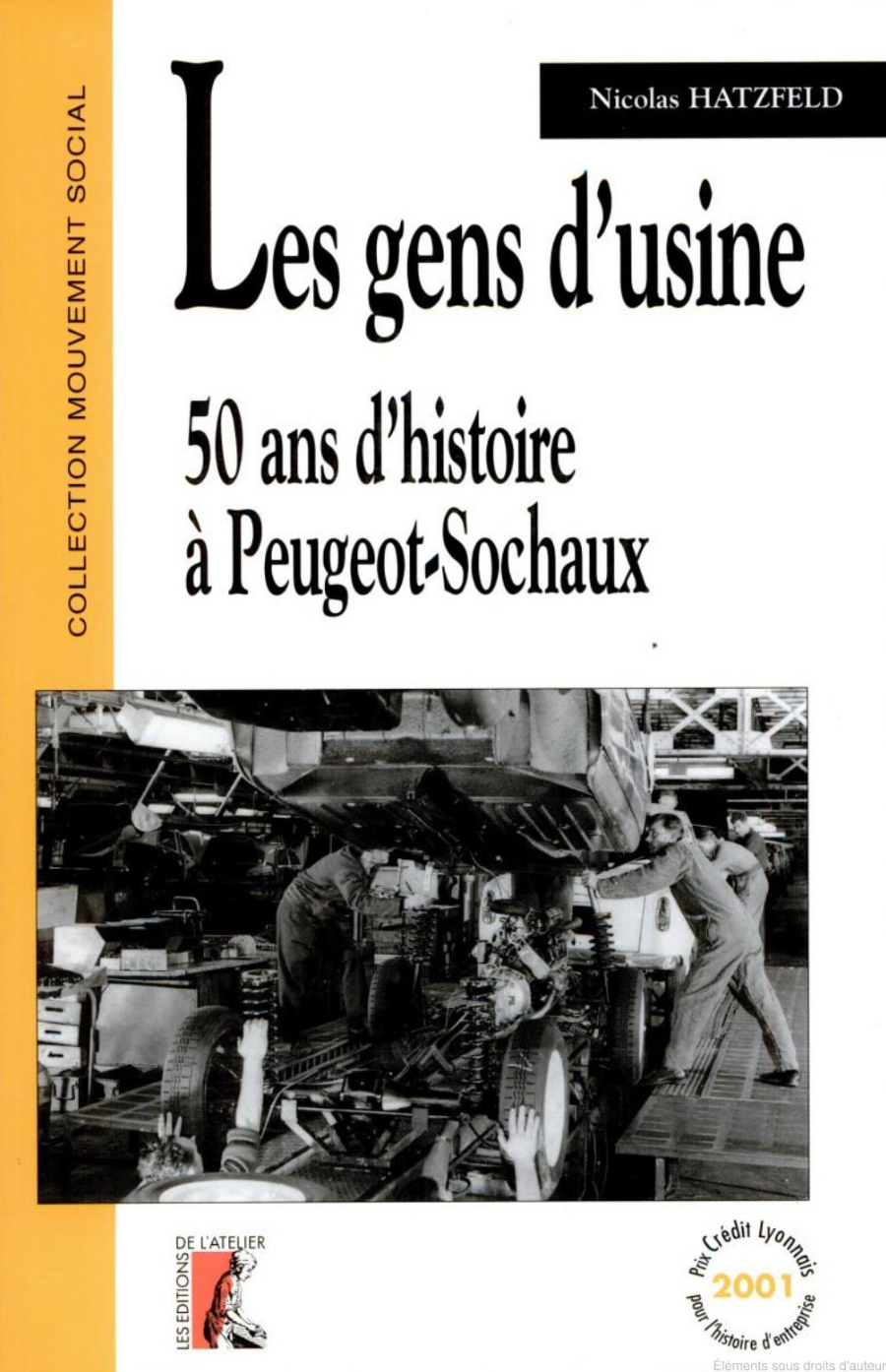
L’individualisation du travail n’est pas apparue seulement en raison de la récente modernisation, liée à la crise ouverte par les nouvelles formes de la concurrence et l’évolution du marché.
Elle s’est amorcée dans les années 1970, en réaction aux événements de 1968, très déstabilisateurs pour le patronat français de l’époque : la violence de la remise en cause du travail taylorisé et de l’autoritarisme, l’explicitation d’un refus de l’exploitation et des inégalités, au nom d’un droit à l’épanouissement personnel (1), tout cela a convaincu le patronat de la nécessité de procéder à des réformes d’ampleur pour contrecarrer cette lame de fond. Son projet est alors simple : mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de minimiser les sources du mécontentement et surtout son expression.
Les assises du Conseil national du patronat français (CNPF) à Marseille, en 1972, posent la question de l’humanisation et de la revalorisation du travail. A la même époque, le gouvernement cherche, lui aussi, des solutions. Il crée l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), et un secrétariat d’Etat… à la revalorisation du travail manuel. L’objectif officiel est de rendre l’organisation du travail plus attrayante : s’inspirant des expériences scandinaves, les dirigeants d’entreprise introduisent la rotation des tâches, leur élargissement, leur enrichissement et, dans certains cas, ils instaurent des groupes semi autonomes de production.
Mais, dès le début, le patronat concentre ses efforts sur l’individualisation systématique de la gestion des salariés, véritable cheval de Troie lancé dans la bataille pour inverser un rapport de forces devenu par trop défavorable et lié à l’extension de la classe ouvrière. Conçue pour miner la capacité des salariés à contester de façon massive, cette individualisation prétend satisfaire certaines aspirations manifestées en 1968, telle la prise en compte de la personne, de ses besoins, de son mérite.
C’est alors le début d’une longue série de réformes qui vont significativement transformer la vie au travail sans changer fondamentalement le travail. En ligne de mire, tout ce qui est collectif.
Cela commence au début des années 1970, quand l’introduction des horaires variables ou à la carte individualise l’arrivée et le départ au travail. Cela désoriente les syndicats : ils ne peuvent aller à l’encontre de ce qui est vécu par les salariés comme un desserrement des contraintes, mais ils se trouvent confrontés à un problème de contact avec les salariés et de distribution des tracts. La revue du CNPF consacre l’année 1976 comme « l’an I de l’horaire souple » (2).
Dans sa thèse sur l’histoire de l’usine Peugeot de Sochaux, Nicolas Hatzfeld relate de façon magistrale la mise en place de cette stratégie post-68 dont les objectifs sont clairs :
« Démassifier, revaloriser-hiérarchiser, personnaliser », selon la formule établie par le responsable de la gestion des personnels ouvriers. Il s’agit de « briser la logique massive qui découle de la conjonction de deux éléments : l’organisation taylorienne du travail d’un côté, et la puissance d’un syndicalisme de classe représenté par la CGT et la CFDT de l’autre côté (3) ».
Cela s’accompagne de l’individualisation des primes et des augmentations de salaire. C’est à cette époque qu’apparaissent, dans les conventions collectives, des critères qui ne s’appuient plus seulement sur la définition des qualifications requises pour un poste de travail mais également sur les « compétences des salariés ». Ils sont appelés « critères classants ». La volonté affichée est de moderniser les grilles de classification, mais cette modernisation se fait en brisant les logiques collectives.
L’importance accordée dès le début des années 1970 à la communication d’entreprise, destinée à faire passer d’autres valeurs que celles véhiculées par les organisations syndicales, poursuit le même objectif. Tout comme la mise en place de cercles de qualité, à la même période, anticipant le grand élan participatif. Le patronat veut instaurer des relations directes entre les salariés et leur hiérarchie, afin de marginaliser l’influence des collectifs, décrétés archaïques.
Parachevant cette approche, les années 1990 voient se généraliser les entretiens directs : le salarié s’engage auprès de son supérieur immédiat à réaliser un certain nombre d’objectifs et participe à l’évaluation de ses performances un an plus tard, comme dans une sorte de confessionnal où il doit vanter ses mérites et avouer ses fautes ou ses insuffisances.
Ces évolutions ont conduit à une réelle atomisation remplaçant les anciens rapports sociaux, qui se caractérisaient par l’existence de puissants collectifs informels et par une solidarité de classe (4), comme l’ont montré les spécialistes de l’histoire sociale de l’entreprise.
Danièle Linhart, Directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Cresppa-GTM-université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, auteure notamment de
Travailler sans les autres ?, Seuil, Paris, 2009.
——–
(1) Ce que Luc Boltanski et Eve Chiapello analysent comme la coexistence d’une critique esthétique et sociale dans leur ouvrage Le Nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, coll. « NRF Essais », Paris, 1999.
(2) Cf. Béatrice Piazza Baruch, « Stratégies de communication interne et transformation des rapports sociaux dans l’entreprise », thèse de sociologie, Université d’Evry, 2001.
(3) Nicolas Hatzfeld, Organiser, produire, éprouver : histoire et présent de l’usine de carrosserie de Peugot à Sochaux (1948-1996), thèse de doctorat d’histoire, Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, 2000.
(4) Lire notamment Nicolas Hatzfeld, Les Gens d’usine à Peugeot-Sochaux, Cinquante ans d’histoire, L’Atelier, Paris, 2002.
Cliquez sur l’image pour accéder au livre
Le 26 août 2019